Valoriser son entreprise, ce n’est pas un calcul comptable, c’est un exercice stratégique. Entre projections ambitieuses, absence de rentabilité immédiate, marchés en construction et traction encore fragile, les méthodes classiques doivent être adaptées à la réalité des jeunes entreprises innovantes.
Mais au fait, qu’est-ce qu’une start-up ?
Une start-up est une entreprise jeune, innovante et à fort potentiel de croissance, souvent en phase de développement de son produit ou de recherche de son modèle économique. Elle évolue dans un environnement incertain, avec l’objectif d’atteindre rapidement une forte scalabilité, souvent grâce à la technologie ou à un positionnement disruptif sur son marché.
DCF, multiples, cost-based, royalties… chaque approche présente ses avantages et ses limites. Dans cet article, nous vous guidons à travers les principales méthodes de valorisation utilisées dans l’écosystème start-up, avec des conseils pour choisir celle qui correspond le mieux à votre stade de maturité.
Pourquoi la valorisation est-elle un sujet aussi sensible ?
Une mauvaise valorisation peut avoir des effets destructeurs.
Trop élevée, elle freine les tours suivants, fait fuir les investisseurs ou mène à des conditions draconiennes. Trop basse, elle dilue inutilement les fondateurs, crée des tensions internes et affecte la crédibilité de l’entreprise.
Le bon réflexe : adapter la méthode à votre contexte (maturité, traction, modèle économique, niveau de risque). C’est ce qu’on appelle le framework analytique implicite des investisseurs :
- Taille du marché
- Maturité du modèle
- Cash burn et traction
- Canaux de distribution
- Paysage concurrentiel
- Qualité de l’équipe
1. La méthode DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs
Idéale pour : les entreprises avec une vision long terme claire et des flux de trésorerie prévisibles, souvent à partir du stade de série A ou post-amorçage.
Principe : on estime les cash flows futurs sur 5 à 7 ans, puis on les actualise à un taux reflétant le risque de l’entreprise (souvent le cost of equity pour une start-up). On y ajoute une valeur terminale.
Attention : la méthode DCF suppose une maîtrise des hypothèses (croissance, marge, investissements…). Elle peut être difficile à utiliser si l’entreprise n’a pas encore de revenus stables.
Dans les start-ups, le taux d’actualisation attendu est élevé :
- Seed : 50–70 %
- Série A : 40–60 %
- Growth : 25–40 %
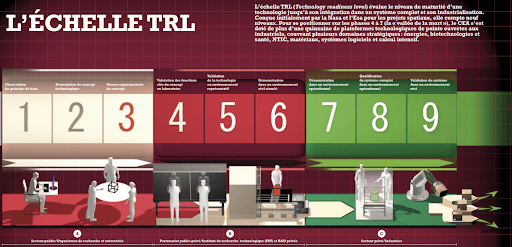
2. La méthode des multiples : comparaison avec le marché
Idéal pour : les entreprises avec un minimum de traction ou une base client existante, même si elles ne sont pas encore rentables.
Principe : on applique un multiple (ex. : x fois le chiffre d’affaires) en se basant sur un échantillon de sociétés comparables du secteur.
Exemples :
- Une start-up SaaS avec 1 M€ d’ARR peut être valorisée entre 5x et 10x ARR, selon la croissance, la récurrence, le churn, etc.
- Un multiple de 7,8x est souvent utilisé comme référence en early-stage tech selon les benchmarks VC
Attention aux biais :
- Il faut retraiter les comparables (niveau de maturité, levée en cours ou exit, marché géographique…)
- Cette méthode ne prend pas en compte les spécificités internes de votre projet (équipe, roadmap, brevets, etc.)
3. La méthode cost-based : valorisation par les investissements réalisés
Idéal pour : les projets en phase très amont (pré-seed, deeptech, biotech), où la traction est faible mais les investissements lourds.
Principe : on valorise l’entreprise en fonction du coût cumulé des ressources mobilisées : R&D, brevets, RH, prototypes, etc.
Variante : “cost to replicate” — combien coûterait-il de refaire ce que vous avez déjà bâti ?
Limite principale : elle ne prend pas en compte le potentiel futur. Elle est donc rarement utilisée seule dans une levée, mais peut servir de base pour négocier avec des institutionnels ou dans les tours très précoces.
Bonus : Valorisation différée et mécanismes d’ajustement
Dans de nombreuses levées early-stage, la valorisation est délibérément flexible. Les investisseurs protègent leur risque avec des outils de réajustement en fonction de la performance.
Exemples :
- Ratchet : si les résultats sont inférieurs aux prévisions, le prix d’entrée est revu à la baisse (et inversement)
- Prêts convertibles avec décote : différer l’entrée au capital en fonction du prochain tour
- Earn-out : partie de la valorisation conditionnée à l’atteinte d’objectifs (CA, EBITDA, nombre d’utilisateurs, etc.)
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la méthode la plus utilisée pour les start-ups ?
La méthode des multiples de chiffre d’affaires est la plus fréquemment utilisée, surtout en amorçage. Elle est simple, directe, et compréhensible par tous les profils d’investisseurs.
Peut-on combiner plusieurs méthodes ?
Oui, et c’est même recommandé. Beaucoup d’investisseurs recoupent plusieurs approches pour affiner leur proposition.
Une valorisation trop basse est-elle toujours une mauvaise chose ?
Pas forcément. Mieux vaut une valorisation raisonnable, assortie de bonnes conditions et de partenaires solides, qu’une valo élevée qui paralyse les tours suivants.
Faut-il laisser les investisseurs imposer leur méthode ?
Non. Vous devez maîtriser les fondamentaux de chaque méthode pour pouvoir discuter intelligemment et justifier vos hypothèses.
Conclusion
La valorisation d’une start-up n’est pas une science exacte, mais un équilibre entre potentiel, risque et crédibilité. Plus que la méthode, ce sont les hypothèses et la cohérence de votre raisonnement qui feront la différence. Travaillez vos chiffres, justifiez vos scénarios, restez ouverts à la discussion. Une bonne valorisation, c’est celle qui aligne les intérêts de tous.





